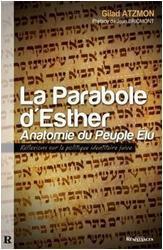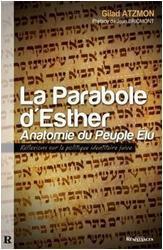 Lorsque Jean Bricmont (physicien belge, ardent défenseur de la liberté d’expression et de la cause palestinienne) a entrepris de rédiger la préface du livre de Gilad Atzmon, La parabole d’Esther (Ed. Demi-Lune, 2012), il ne s’attendait peut-être pas à ce que son texte, pas plus que ce qu’il préfaçait, suscite l’adhésion unanime de tous ses lecteurs. Le propos n’est pas ici de commenter ni le livre d’Atzmon, ni sa préface, mais de constater que tout ce qui concerne de près ou de loin le problème de la Palestine en particulier et celui de la question juive en général est soumis à un contrôle strict et à une sorte de censure morale exercée par les tenants du sionisme et, plus étonnant (ou pas?), par certains de ceux qui se disent soutenir la cause palestinienne.
Le livre de Gilad Atzmon, et au passage son préfacier, ont donc été cavalièrement critiqués par Dominique Vidal (écrivain, spécialiste du Proche-Orient et collaborateur du Monde diplomatique). Critique passablement cavalière et sournoise en effet, intitulée Les protocoles de Gilad Atzmon(on aura perçu l’allusion aux fameux Protocoles des Sages de Sion), qui se contente de relever un nombre assez impressionnant de formules extraites de l’oeuvre en question, et qui ont manifestement horrifié Dominique Vidal. L’auteur précise, au début et à la fin, que tout cela ne « mérite aucun commentaire ». Mais cette absence de commentaire en appelle un : outre qu’il est facile de s’en dispenser, ne pas commenter en dit long sur l’état dans lequel l’auteur suppose être la pensée concernant ces questions épineuses. Car s’il n’est pas besoin de commenter, c’est que les lecteurs sont suffisamment bien programmés pour trouver par eux-mêmes en quoi tout cela est répugnant. Le formatage idéologique a donc bien fait son œuvre et l’horreur d’un propos doit s’imposer d’elle-même.
Or, c’est précisément ce contre quoi s’insurge Jean Bricmont. Il a donc rédigé une longue réponse (argumentée, celle-là), à l’invective de Dominique Vidal.
Soucieux de montrer les différents points de vue dans cette polémique, et de rappeler combien il est difficile d’affronter le discours et la pensée sionistes dominants, le Comité Action Palestine publie ici dans leur intégralité la préface du livre de Gilad Atzmon, le « commentaire » de Dominique Vidal et la réponse de Jean Bricmont.
À chacun d’en juger par lui-même.
JEAN BRICMONT : LETTRE À DOMINIQUE VIDAL
Cher Dominique Vidal,
Je vois que le livre d’Atzmon, La parabole d’Esther, dont j’ai écrit la préface, n’a pas eu l’heur de vous plaire [http://la-feuille-de-chou.fr/archives/30516« >1] puisque vous estimez que j’ai apporté ma caution à une « prose digne du Völkischer Beobachter », journal officiel du parti national-socialiste [2]. Vous m’en voyez sincèrement désolé. Je ne cherche à blesser personne et, si vous me lisez bien, vous verrez que je ne n’attaque jamais nominalement des individus et encore moins des groupes (« juifs » « arabes », « français » etc.). Je n’utilise le mot « juif » ou « sioniste » que pour parler d’organisations qui, soit utilisent ce terme pour se désigner elles-mêmes (« juifs pour la paix », « juifs progressistes »), soit identifient leur cause à la défense d’Israël.
Je m’intéresse uniquement aux idées, pas aux individus, ni aux identités ou aux groupes. C’est pourquoi s’il y a un point commun entre vous et Atzmon, que je ne partage pas, c’est que vous êtes tous deux bien plus intéressés par l’identité juive que moi. Je vous avouerai que celle-ci me laisse complètement indifférent. J’ai un ami d’origine juive qui, quand on lui demande s’il est juif, répond : « mes grands-parents étaient juifs, mais moi je suis physicien ». N’ayant pas la même origine que lui, je ne peux pas faire cette réponse, mais elle exprime bien mon sentiment par rapport à toutes les questions « identitaires », sentiment qui est parfaitement libéral au sens classique du terme, ce qui, je crois, n’était pas l’idéologie du Völkischer Beobachter (mais il est vrai que je n’ai jamais lu ce journal dont la parution a été interrompue avant ma naissance). Chacun a le droit d’avoir l’identité qui lui plait et de cultiver la mémoire des événements qui lui semblent importants ou sacrés : l’holocauste, la crucifixion de Jésus, la guerre d’Algérie, la victoire sur le nazisme, la chute du mur de Berlin etc. Tout ce que je demande, c’est que, dans un esprit laïc, l’État et les institutions publiques soient strictement neutres par rapport à toutes ces identités, comme ils doivent l’être par rapport aux religions (les deux, identités et religions, n’étant d’ailleurs pas si différentes).
J’ai écrit cette préface, entre autres, afin qu’on ne doive « plus jamais » lire des choses dans le style méprisant et hautain que vous employez : « cette diarrhée nauséabonde condamne sans appel son auteur » ; « cette prose digne du Völkischer Beobachter » ou d’autres reductio ad hitlerum. Ou, à mon propos : « Il est tombé ainsi du côté où il penchait depuis longtemps. Bien bas. »
Un nombre croissant de gens en France, de toutes origines et de toutes opinions politiques, exigent le droit à la parole et n’acceptent plus qu’il y ait des mauvais gardiens du temple, les organisations sionistes qui utilisent l’accusation d’antisémitisme à tout bout de champ, et des bons gardiens du temple, les juifs progressistes et pro-palestiniens qui utilisent l’accusation d’antisémitisme uniquement quand c’est, selon eux, « justifié ». Nous ne voulons ni gardiens du temple, ni inquisition, ni comité central. C’est ainsi ; les temps changent…
Nous voulons les mêmes règles pour tous, des lois mémorielles pour tous ou pour personne, une histoire officielle universelle ou pas d’histoire officielle du tout ; nous voulons que, si les spectacles de Dieudonné doivent être interdits, ils le soient après un procès public en bonne et due forme (où on pourrait alors comparer son humour à d’autres formes d’humour) ou alors, que ses spectacles soient autorisés partout et non soumis aux caprices des maires ou des pressions exercées sur les propriétaires de salles de spectacle. Si Bernard-Henri Lévy peut lancer des appels à la guerre contre la Libye et la Syrie, et si Caroline Fourest peut attaquer les musulmans en prétendant les défendre, alors des gens aussi différents qu’Alain Soral, Tariq Ramadan ou Michel Collon doivent avoir accès à des salles de conférences sans avoir au préalable l’agrément d’organisations qui jouent à l’anti-fascisme près de 70 ans après la fin de la guerre.
Pensez-vous vraiment que tous les écrits anti-religieux, anti-fascistes, anti-colonialistes, anti-communistes soient des vérités pures, dénués de toute exagération, de toute simplification et de tout amalgame ? Ou mettez-vous, si c’est possible, à la place d’un catholique français un peu « tradi » et demandez-vous comment vous réagiriez au discours tenu sur votre « culture » ou « identité » presque constamment dans les colonnes de Charlie Hebdo ou de Libération ou dans des spectacles ridiculisant le Christ et lourdement subventionnés par les pouvoirs publics.
La liberté d’expression, c’est aussi la liberté d’exagérer, de provoquer, de faire des raccourcis. Contrairement à vous, Atzmon a grandi en Israël et a servi dans son armée. Il a été révolté par ce qu’il y a vu -il me semble que c’est tout à son honneur. Il s’est exilé volontairement. Il a voulu analyser en profondeur l’idéologie nationaliste dans laquelle il a grandi et qui justifie les horreurs contre lesquelles il s’est révolté. N’est-ce pas son droit ? Cette idéologie, que vous le vouliez ou non, est judéo-centrique et, dans sa version « laïque », consiste, pour reprendre un mot de Woody Allen, à penser que« Dieu n’existe pas et nous sommes son peuple élu ». Il y a quantité de textes qui attestent de la croyance en la singularité juive et, au moins implicitement, en la supériorité juive. Cela ne me dérange pas et je ne trouve là rien de spécifiquement « juif », beaucoup de groupes humains ayant ce genre de sentiments. Mais, si on est véritablement universaliste, on peut aussi critiquer cette attitude et il me semble que c’est d’autant plus légitime quand c’est fait par quelqu’un qui attaque son propre « tribalisme » et, dans le cas d’Atzmon, d’autant plus pertinent que les folies israéliennes risquent de précipiter le monde dans une guerre généralisée.
Atzmon a une vue « idéaliste » de l’histoire, au sens marxiste du terme ; c’est-à-dire qu’il privilégie les explications en terme de culture plutôt qu’en termes socio-économiques ou de rapports de classes. Ce n’est pas mon cas, mais c’est son droit. Lorsque Weber attribue un grand rôle à l’éthique protestante dans la naissance du capitalisme, on peut ne pas être d’accord avec lui, mais personne ne l’accuse de racisme pro ou anti-protestant (selon que l’on aime ou pas le capitalisme). De même quand Bernard-Henry Lévy estime que l’idéologie française, c’est le fascisme, personne ne l’accuse de racisme anti-français, même si sa thèse est absurde. Il y a quantité de textes attribuant l’origine des massacres coloniaux ou de l’holocauste à des facteurs culturels, européen, chrétien, allemand, français, républicain, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas s’interroger sur les facteurs culturels, nécessairement juifs, à l’origine de la politique israélienne contemporaine ?
Vous me direz sans doute que la prose d’Atzmon « ne sert pas la cause palestinienne ». Je vais être franc : je ne sais pas très bien ce qui pourrait desservir plus cette cause que la tactique employée actuellement par le plus gros du mouvement « de solidarité ». Ce mouvement est obsédé par la lutte contre l’antisémitisme, dont le moindre soupçon desservirait soi-disant la « cause », ce qui explique les réactions hystériques contre Atzmon. Je ne connais pas bien le Hamas ou le Hezbollah, mais je doute fort que, si un de leurs membres citait, par exemple, une phrase hostile aux juifs tirée du Coran, ses compagnons lui tomberaient dessus en criant « surtout pas d’antisémitisme, cela dessert notre cause ». Et si on compare leur efficacité dans la résistance à Israël par rapport à celle du mouvement de solidarité en France qui, non seulement n’a aucune influence au Moyen-Orient, mais n’en a également pratiquement aucune en France, où presque tous les hommes politiques se précipitent aux dîners du CRIF et autres cérémonies« républicaines », on peut commencer à se poser des questions sur l’efficacité (du point de vue palestinien) de la « lutte contre l’antisémitisme ». Ni Atzmon ni moi ne voulons encourager ou propager l’antisémitisme ; nous constatons simplement que l’accusation d’antisémitisme est l’arme préférée des sionistes et que la principale, sinon la seule raison du soutien occidental à Israël (qui ne sert en rien l’Occident sur le plan stratégique ou militaire), est l’intimidation que cette accusation, ainsi que l’intériorisation de la culpabilité inculquée à travers une myriade de films, de livres et de cours, font peser sur nos journalistes, intellectuels et hommes politiques. Ce sont l’intimidation et le sentiment de culpabilité qu’il faut faire cesser en premier lieu.
Voyez ce qui se passe avec Günter Grass (et notez qu’il n’y a pas d’équivalent de Günter Grass en France). Vous pensez qu’après tout ce qu’il encaisse, un seul homme politique va oser critiquer Israël ? Je suis sûr que vous défendez la liberté d’expression de Grass et c’est très bien. Mais Grass est très modéré, s’excuse encore pour ce qu’il a fait dans le passé (à l’âge de 17 ans !), distingue l’État d’Israël de son gouvernement etc., et même cela ne suffit pas à calmer la meute de ses détracteurs. Je ne désire nullement devoir me limiter à ce que dit Grass. Mais, surtout, comme je l’ai dit plus haut, ce que nous ne voulons plus, ce sont de « vrais » gardiens du temple qui décident ce qu’est le « véritable » antisémitisme. Laissez cela au libre débat et à l’appréciation de chacun. Bien sûr, vous avez le droit de critiquer Atzmon. Mais faire une liste de citations hors contexte (qu’Atzmon peut facilement expliquer) et renvoyer au Völkischer Beobachter, ce n’est pas de la critique, c’est de l’hystérie et du mépris.
Je n’aurais jamais écrit cette préface si Atzmon n’était sans cesse attaqué par une partie du « mouvement de solidarité » avec la Palestine. Pour moi, peu importent les motivations « identitaires » des juifs pro-palestiniens ; si des juifs s’opposent à Israël parce qu’ils pensent qu’à terme, c’est mauvais pour les juifs, ils ont sans doute raison et c’est très bien ainsi. Ce qui distingue un soutien véritable d’un soutien fictif à la cause palestinienne se joue dans l’attitude à l’égard de la liberté d’expression. Sommes-nous libres de dire ce que nous pensons d’Israël et des organisations juives ou devons-nous recevoir l’approbation de grandes consciences morales auto-proclamées ? Tout ce qu’on peut dire ici sur un État, deux États, tel ou tel processus de paix, les violations des droits de l’homme, ou du droit international, ou sur la possibilité d’un autre Israël ou même sur le droit au retour, n’auront aucun effet tant que la plupart des gens seront terrorisés par l’accusation d’antisémitisme. Mais, si nous arrivons à reprendre notre liberté de parole, alors, ne vous en faites pas, l’attitude par rapport à Israël changera rapidement. C’est en cela que réside le véritable enjeu du « soutien à la Palestine ».
Ce que vous semblez aussi ne pas comprendre, c’est qu’Atzmon en fait défend les juifs (au moins « objectivement » j’ignore si c’est là son but). Atzmon est un juif inquiet ; un juif optimiste pense qu’Israël va rester éternellement une « villa au milieu de la jungle », haïe au-delà de toute raison par des centaines de millions de personnes dans les pays voisins, mais demeurant une citadelle imprenable. De même, un juif optimiste pense que les États-Unis vont éternellement rester sous le contrôle du lobby pro-israélien. Mais Atzmon pense, comme toute personne ayant une certaine perspective historique, que les murs et les citadelles finissent toujours par tomber (songez à l’URSS). De plus, il se rend compte que, suite à l’extraordinaire travail de Mearsheimer et Walt (et de bien d’autres : Findley, Petras, Blankfort, Sniegoski [3]), les Américains (y compris la « classe dominante ») commencent à se réveiller : ils se rendent compte que le soutien à Israël leur coûte énormément et ne leur apporte que de l’hostilité. Que la guerre en Irak n’était absolument pas nécessaire, leur a coûté une fortune, et ne leur a presque rien rapporté ; que, de plus, celle-ci a été entièrement fomentée par les néo-conservateurs, qui sont tous des sionistes fanatiques, et qui veulent repasser les plats avec l’Iran. Allez sur les sites qui discutent de cela, même ceux qui sont « politiquement corrects » comme Mondoweiss (http://mondoweiss.net/), et vous verrez la fureur des Américains « ordinaires » qui voient la politique étrangère de leur pays (qu’eux voient souvent avec bienveillance, contrairement à moi, mais c’est une autre question), être kidnappée par le lobby pro-israélien. Atzmon pense sans doute qu’il vaut mieux, pour les juifs eux-mêmes, lâcher du lest, libérer la parole à propos d’Israël et des organisations juives, laisser sortir la vapeur de la casserole avant que tout ne saute. Ce n’est pas de l’antisémitisme, mais de la lucidité.
Ne pensez pas que la situation soit très différente en France : lors des spectacles de Dieudonné, la salle est pleine à craquer et, quand on interdit à Alain Soral l’accès à une salle de conférence, il arrive quand même à en remplir une autre. Vous me direz qu’ils sont d’extrême-droite et antisémites. Admettons, pour simplifier la discussion (même si la réalité est plus complexe). Mais leur succès est en partie dû au refus obstiné de l’immense majorité de la gauche et des « démocrates » d’aborder honnêtement la question de la liberté d’expression en France et de l’égalité de tous devant la loi. De plus, on ne nait pas antisémite, on le devient (dans la plupart des cas). Et on le devient aujourd’hui à cause de l’arrogance des politiques israéliennes et des efforts de censure souvent déployés avec succès par les organisations juives. Cela ne « justifie » pas l’antisémitisme me direz-vous. Non, bien sûr, mais les gens qui ignorent la psychologie humaine (y compris dans ses aspects pas très jolis) le font à leurs risques et périls. Et, comme je l’ai dit dans ma préface, ceux qui ne comprennent pas cela devraient réfléchir à l’histoire du socialisme réel, que vous avez bien connu, ou du catholicisme à l’époque de sa gloire, que moi j’ai bien connu. Atzmon comprend tout cela, vous apparemment non. C’est dommage, mais il n’est peut-être jamais trop tard pour comprendre.
Atzmon, comme moi-même, restons ouverts au débat.
Avec mes meilleures salutations,
Jean Bricmont / le 21 avril 2012.
LES PROTOCOLES DE GILAD ATZMON
Plusieurs « amis » sur Facebook, dont Brahim Senouci, m’ont demandé pourquoi je m’interrogeais sur la vigilance nécessaire à l’égard de tout dérapage antisémite ou islamophobe. Côté islamophobe, les exemples nemanquent pas. Mais il en existe aussi côté antisémite. Voici des extraits du dernier « livre » de Gilad Atzmon, qui n’appellent pas de commentaire – sauf que cet auteur a été défendu par le site Info-Palestine…
Les protocoles de Gilad Atzmon
Intellectuel israélien exilé à Londres, Gilad Atzmon est connu pour ses écrits « borderline ». Mais, avec La parabole d’Esther (1), il dépasse toutes les bornes. Sous titré Anatomie du peuple élu, réflexion sur la politique juive contemporaine, ce « livre » se présente comme un florilège de tous les poncifs de l’antijudaïsme le plus vulgaire, salué par le site de Silvia Cattori (2) et défendu par celui d’Info-Palestine (3).
Quelques citations, parmi tant d’autres, suffisent à s’en convaincre :
– « Si l’argumentaire colonial a été populaire durant un certain temps, c’est non seulement parce qu’il exonérait les juifs (en tant que peuple) des crimes perpétrés par Israël, mais aussi parce qu’il comportait une promesse : tôt ou tard, l’“État colon israélien” grandirait, sortirait de son cauchemar colonial, et la paix pourrait éventuellement l’emporter » (page 28);
– « Dès lors qu’Israël se définit comme l’“État juif”, nous sommes parfaitement en droit de nous interroger sur la signification réelle des notions de judaïsme, judéité, culture et idéologie juives » (page 29);
– « J’ai franchi certaines lignes jaunes en toute conscience. J’examine philosophiquement les aspects tribaux inhérents au discours juif séculier tant sioniste qu’antisioniste » (page 29);
– « Le nationalisme juif est un état d’esprit, et une mentalité n’a pas de frontières clairement tracées. En fait, personne ne sait où, exactement, finit la judéité et où commence le sionisme, et vice-versa » (page 30);
– « Manifestement, nous n’avons pas affaire seulement à Israël et aux Israéliens. En réalité, nous sommes en conflit avec une philosophie pragmatique extrêmement déterminée qui génère et promeut des conflits internationaux d’ampleur gigantesque » (page 30);
– « Il s’agit en réalité d’une guerre contre une mentalité regrettable qui a pris l’Occident en otage et l’a, tout au moins momentanément, détourné de ses inclinations humanistes et de ses aspirations athéniennes » (page 31);
– « J’ai compris qu’Israël et le sionisme n’étaient que des sous-parties constituantes d’un problème beaucoup plus vaste, le problème juif » (page 51);
– « Le sionisme n’est pas un mouvement colonialiste ayant des intérêts en Palestine, contrairement à ce que suggèrent certains spécialistes. Le sionisme, en réalité, est un mouvement mondial alimenté par une solidarité tribale sans équivalent » (page 56);
– « Tout au long des siècles, certains banquiers juifs ont acquis la réputation d’être des partisans et des financeurs de guerres, et même d’une révolution communiste » (page 66) ;
– « L’Holocauste a été une “victoire sioniste”, exactement de la même manière que tout viol est interprété par les idéologues féministes séparatistes comme une vérification de la validité de leurs théories » (page 85);
– « En raison de la nature raciste, expansionniste et judéo-centrique de l’État juif, le juif de la Diaspora se trouve intrinsèquement associé à une idéologie intégriste et ethnocentrique, ainsi qu’à une interminable liste de crimes contre l’Humanité » (page 92) ;
– « En juxtaposant des stéréotypes juifs (ceux que les juifs semblent abhorrer par opposition à ceux que les propagandistes ethniques juifs s’efforcent de promouvoir), on pourrait sans doute mettre en lumière, de manière cruciale, certaines problématiques relatives à l’identité juive » (page 95) ;
– « Les antisionistes d’origine juive (cette catégorie peut englober des gens haineux d’eux-mêmes et fiers de l’être, comme moi) sont là pour donner une image de pluralisme idéologique et de souci de l’éthique » (page 118) ;
– « Le socialisme juif, comme le socialisme, est une idéologie sans équivalent, ésotérique, avant tout préoccupée des intérêts juifs et de la judéité » (page 124);
– « Le socialisme et le militantisme progressiste juifs s’intègrent parfaitement dans le projet sioniste. En tant que parties constitutives du projet sioniste, ils ont pour rôle de rassembler les âmes perdues parmi les juifs humanistes et de les ramener à la maison pour Hanouka » (page 125);
– « Le débat entre les sionistes et les soi-disant “juifs antisionistes” n’a strictement aucun impact sur Israël ni sur la lutte contre la politique israélienne. Il a pour seule fin de maintenir le débat “au sein de la famille”, tout en semant davantage de confusion chez les Goyim. Cela permet aux militants juifs ethniques prétendument “progressistes” d’affirmer que “tous les juifs ne sont pas sionistes”. Cet argument de peu de poids a pourtant réussi à faire voler en éclats toute critique du lobbying juif ethnocentrique qui a pu être exprimée au cours des quatre décennies passées » (page 157);
– « Quand il s’agit de “passer à l’action” contre les soi-disant “ennemis du peuple juifs”, les sionistes et les “juifs antisionistes” se comportent comme un seul homme, comme un seul peuple, pour la bonne raison qu’ils sont effectivement un seul et même peuple » (page 157);
– « Le légendaire Matzpen progressiste et les néoconservateurs réactionnaires ont recours au même concept abstrait, non sans prétendre à l’universalité, pour justifier rationnellement le droit juif à l’autodétermination et à la destruction de tout pouvoir régional édifié par les Arabes et l’islam » (page 166);
– « Très souvent nous entendons dire à propos de juifs de gauche que leur affinité pour les problèmes humanitaires résulte de leur “héritage humaniste juif”. Plus d’une fois, j’ai moi-même expliqué que c’est là un mensonge absolu. Il n’existe pas d’héritage juif de cette nature. Déterminés qu’ils sont par des préceptes tribaux, tant le judaïsme que l’“idéologie juive” sont exempts de toute éthique universelle » (page 172);
– « Le vol interminable de la Palestine au nom du peuple juif fait partie d’un continuum spirituel, idéologique culturel et pratique entre la Bible, l’idéologie sioniste et l’État d’Israël sans oublier ses zélotes d’outremer. Israël et le sionisme (…) ont institué le pillage promis par le Dieu hébreu dans les écritures saintes ïques (page 182);
– « On dirait que l’armée israélienne, en rayant de la carte de lors de la bande de Gaza, en janvier 2009, mettait en application le verset du Deutéronome 20 :16 ; de fait, elle n’a “laissé la vie à rien de ce qui respire” » (Page 184);
– « Le vol et la haine imprègnent l’idéologie juive contemporaine, que celle-ci soit de gauche ou de droite » (page 185);
– « Alors que le contexte biblique judaïque est plein de références à des faits violents habituellement commis au nom de Dieu, dans le contexte national et politique juif contemporain les juifs tuent et volent en leur propre nom, au nom de l’autodétermination, de la “politique de la classe laborieuse”, de la “souffrance juive” et de leurs aspirations nationales » (page 185);
– « Si Shlomo Sand est dans le vrai (…), si les juifs ne sont pas une race et s’ils n’ont rien voir avec le sémitisme, alors l’“antisémitisme” est formellement un mot vide de sens. Autrement dit, la critique du nationalisme, du lobbying et du pouvoir juifs ne peut être considérée comme autre chose qu’une critique légitime d’un idéologie, d’une politique et d’une praxis » (page 212);
– « Il m’a fallu des années pour comprendre que l’Holocauste, cette croyance centrale de la foi juive contemporaine, n’était pas un récit historique, dès lors que les narrations historiques n’ont que faire de la protection de la loi et des politiciens » (page 215);
– « La religion de l’Holocauste est de toute évidence judéo-centrique jusqu’à la moëlle. Elle définit la raison d’être juive. Pour les juifs sionistes, elle signifie un épuisement total de la Diaspora et elle fait du Goy un assassin irrationnel en puissance. Cette nouvelle religion juive prêche la revanche. Il pourrait s’agir de la religion la plus sinistre de tous les temps car, au nom de la souffrance juive, elle délivre des permis de tuer, d’écraser, de nucléariser, d’annihiler, de piller, d’épurer ethniquement. Elle a fait de la vengeance une valeur acceptée en Occident » (page 216);
– « La religion de l’Holocauste est le stade final, conclusif, de la dialectique juive (…) Au lieu d’avoir besoin d’un Dieu abstrait pour désigner les juifs en tant que peuple élu, dans la religion de l’Holocauste, les juifs se passent de ce divin intermédiaire et ils s ‘élisent eux-mêmes » (page 217);
– « Ceux qui tentent de réviser l’Histoire de l’Holocauste sont victimes de mauvais traitements des grands prêtres de cette religion (…) Nous ne sommes pas autorisés à y toucher, pas plus qu’il ne nous est permis de l’examiner » (page 220);
– « La religion de l’Holocauste était déjà bien établie très longtemps avant la Solution finale (1942), bien avant la Nuit de Cristal (1938), les Lois de Nuremberg (1936) et même avant la naissance d’Hitler (1889). La religion de l’Holocauste est sans doute aussi ancienne que les juifs le sont eux-mêmes » (page 221);
– « La morale de cette histoire [celle d’Esther] est très claire : si les juifs veulent survivre, ils ont intérêt à infiltrer les arcanes du pouvoir. À la lumière du Livre d’Esther, e Mardochée et de Pourim, l’AIPAC et la notion de “pouvoir juif” semblent l’incarnation d’une idéologie profondément biblique et culturelle » (page 226);
– « L’authenticité historique du Livre d’Esther est très largement remise en cause par la plupart des biblistes contemporains (…) Autrement dit, toute considération morale mise de côté, la tentative de génocide décrite est fictive » (page 227);
– « Le Livre d’Esther esquisse une identité exilique. Il provoque le stress existentiel et constitue un prélude à la religion de l’Holocauste » (page 227);
– « Tant dans Exode que dans le Livre d’Esther, l’auteur du texte réussit à prédire le genre d’accusations qui allaient être jetées contre les juifs pour les siècles à venir, telle que la recherche du pouvoir, le tribalisme et la tricherie. De manière choquante, le texte d’Exode fait penser à une prophétie de l’Holocauste nazi (…) Pourtant, aussi bien dans Exode que dans le Livre d’Esther, au final, ce sont les juifs qui tuent » (page 228);
– « Il m’a fallu des années pour comprendre que mon arrière grand-mère n’avait pas été transformée en “savonnette” ou en “abat-jour” contrairement à ce qu’on m’enseignait en Israël. Ella a sans doute péri d’épuisement ou du typhus, ou peut-être a-t-elle été victime d’un mitraillage collectif (au cours de ce qu’on appelle la Shoah par balles). C’était assurément triste et tragique, mais cela n’est pas très différent du sort qu’ont connu des millions d’Ukrainiens qui ont eu à apprendre le sens réel du mot communisme. Le sort de mon arrière grand-mère n’a pas été très différent de celui de centaines de milliers de civils allemands tués dans un bombardement aveugle cyniquement orchestré, pour l’unique raison qu’ils étaient allemands » (page 248);
– « Soixante-six ans après ans après la libération du camp d’Auschwitz, nous devrions pouvoir poser la question du “pourquoi”. Pourquoi les juifs étaient-ils haïs ? Pourquoi les peuples européens se sont-ils levés pour faire la guerre à leurs voisins ? Pourquoi les juifs sont-ils haïs au Moyen-Orient, où ils avaient sûrement une chance d’ouvrir une nouvelle page de leur histoire ? S’ils avaient envisagé de le faire, comme le clamaient les pionniers du sionisme, pourquoi ont-ils échoué ? Pourquoi l’Amérique a-t-elle durci ses lois d’immigration au plus fort du danger pour les juifs européens ? Nous devons aussi nous demander à quoi servent, au juste, les lois sanctionnant le négationnisme de l’Holocauste ? Qu’entend cacher la religion de l’Holocauste ? Tant que nous ne nous poserons pas de questions, nous serons assujettis aux sionistes et à leurs complots. Nous continuerons à tuer au nom de la souffrance juive » (page 249);
– Et les dernières lignes de l’épilogue du « livre » sont les suivantes : « Je ne saurais laisser passer l’opportunité qui m’est ici offerte de remercier du fond du cœur ma demi-douzaine de détracteurs juifs marxistes qui m’ont harcelé, moi et ma carrière musicale, nuit et jour, des années durant, et sans lesquels je n’aurais jamais pris toute la mesure e la profondeur de la férocité tribale. Ce sont ces activistes juifs soi-disant “antisionistes” qui m’ont appris infiniment plus de choses que n’importe quel sioniste enragé au sujet de la véritable signification pratique – ô combien dévastatrice – de la politique identitaire juive » (page 268).
Fermez le ban ! Une telle prose ne mérite aucun commentaire : cette diarrhée nauséabonde condamne sans appel son auteur. Et son préfacier : car le Belge Jean Bricmont a cru bon d’apporter sa caution à cette prose digne du Völkischer Beobachter. Il est tombé ainsi du côté où il penchait depuis longtemps. Bien bas…
Dominique Vidal.
NOTES:
(1) Editions Demi-Lune, Plogastel Saint-Germain, 2012.
(2) www.silviacattori.net/
(3) www.info-palestine.net/
Préface de M. Jean Bricmont
Lire Gilad Atzmon
«Un des fondateurs de l’International Solidarity Movement m’a dit qu’il préférait de beaucoup se battre contre un soldat israélien à un barrage routier que de se battre contre nos détracteurs juifs `anti’-sionistes. Je n’aurais pas pu être plus d’accord. » Gilad Atzmon, interview avec Silvia Cattori.(1)
Des amis pro-palestiniens m’avaient plusieurs fois mis en garde : Gilad Atzmon est antisémite, il dessert la cause palestinienne, peut-être même travaille-t-il pour Israël. Sans doute ai-je un mauvais esprit, mais cela ne m’a pas empêché de lire régulièrement son blog (au contraire), avec un mélange de fascination et d’amusement. Il me semblait qu’un juif israélien vivant en Angleterre, exilé volontaire, qui est accusé d’antisémitisme, entre autres par des juifs pro-palestiniens, et contre lequel manifestent des organisations « antiracistes » lorsqu’il donne des conférences, était au minimum une curiosité digne d’intérêt. De plus, m’étant moi-même «échappé» de la religion dans laquelle on m’a forcé à grandir (le catholicisme), j’ai une sympathie instinctive pour tous ceux qui rompent, souvent brutalement, avec les mythes et les contraintes de leur enfance. Les thèmes abordés par Atzmon, la politique de l’identité et de la mémoire, sont au coeur des débats de société contemporains. Il devrait être possible d’écouter un point de vue vraiment politiquement incorrect sur ces questions, celui de quelqu’un qui se définit comme un «juif haineux de lui-même et fier de l’être».
Mais un tel intérêt, venant d’un non-juif comme moi, n’est-il pas lui-même suspect, voire carrément, nauséabond? Ne nous renvoie-t-il pas « aux-heures-les-plus-sombres-de-notre-Histoire » ? Lorsque l’éditeur d’Atzmon m’a proposé d’écrire cette préface, je me suis dit que ce serait l’occasion de répondre à cette question et surtout d’expliquer pourquoi Atzmon doit pouvoir être lu, ainsi que les différences entre son point de vue et le mien.
Il est très facile de « démontrer » le prétendu antisémitisme d’Atzmon : celui-ci distingue fréquemment, y compris au début de son livre, trois sens du mot «juif» : les gens d’origine juive, avec lesquelles il n’a aucune querelle, les personnes de religion juive, avec lesquelles il n’a également aucune querelle et ceux qu’il appelle de la troisième catégorie, c’est-à-dire ceux qui, sans être particulièrement religieux, mettent constamment en avant fleur « identité » juive et la font passer avant et au-dessus de leur simple appartenance au genre humain. Il suffit alors d’interpréter selon la première définition (les gens d’origine juive) le mot «juif» chez Atzmon, lorsqu’il est utilisé dans le troisième sens, dans un discours dont le style est souvent extrêmement polémique, pour « faire ainsi la preuve » de son antisémitisme.
Néanmoins, lorsqu’un essayiste français utilise toute son influence, qui est immense, pour pousser son pays dans une guerre contre la Libye et qu’il déclare ensuite avoir agi là « en tant que juif» et en portant en étendard la «fidélité » à son nom (et à la cause sioniste) — ce qui n’est pas exactement un argument rationnel, mais les guerres sont-elles faites au nom d’arguments rationnels ? — il devrait au moins être permis aux personnes qui ne sont pas d’origine juive de s’interroger sur cette identité juive au nom
(2) de laquelle ils sont entraînés dans un conflit qui, quoi qu’on en pense, n’était sûrement pas une guerre de défense de la France.
Est-il légitime de critiquer les juifs au sens de la troisième catégorie d’Atzmon ? Tout d’abord, il est évident que chaque individu a parfaitement le droit de se « sentir » appartenir à un groupe dont il est fier, ou dont il pense qu’il apporte quelque chose d’important à l’idée qu’il se fait de lui-même, qu’il s’agisse de juifs, de Bretons, de Français, de catholiques, de Noirs, de musulmans etc. Comme toutes ces identités sont liées aux hasards de la naissance, ces sentiments de fierté sont irrationnels, mais qui pourrait forcer les êtres humains à être rationnels ?
Le problème se pose quand ces identités bénéficient d’un statut politique privilégié, exactement comme lorsque les religions acquièrent un tel statut. Quand une communauté, groupée autour de son « identité», revendique certains droits — ou compensations, ou privilèges — il doit être permis à d’autres, ne partageant pas l’identité en question, de critiquer le bien-fondé de ces revendications (étant Belge, je suis malheureusement habitué à ce genre de débats). Exactement comme lorsqu’une religion cherche à imposer sa morale au reste de la société. Une politique de l’identité existe chez les Noirs, les musulmans, les homosexuels, les femmes, etc. On pourrait d’ailleurs penser que la politique actuelle est de plus en plus réduite au conflit des identités, les questions socio-économiques étant désormais confiées à la (sage ?) gestion d’experts non élus. Mais il existe aussi une politique identitaire juive, dont les enjeux dépassent de loin le conflit israélopalestinien et qui affecte, entre autres, la liberté d’expression ou les rapports avec les musulmans.
Mais alors que les revendications identitaires, surtout musulmanes, sont régulièrement attaquées dans l’espace public, le grand mérite d’Atzmon est de reconnaître l’existence d’une politique identitaire juive et de la critiquer, ce que pratiquement personne d’autre n’ose faire.
La façon d’en finir avec la politique de l’identité réside sans doute dans une extension du concept de laïcité à la séparation entre identité et État, ainsi qu’entre tout sacré ou toute mémoire et l’État, ou même la politique. Chaque individu devrait pouvoir définir le groupe auquel il pense appartenir, les événements qu’il considère importants ou sacrés dans l’Histoire et dont il estime qu’il faudrait se souvenir. Mais l’État et toutes les institutions publiques, comme les écoles et les universités, devraient être strictement neutres par rapport à ces choix. Dans une démocratie laïque, la politique devrait porter sur la gestion collective de la cité, sur les lois et les règlements, ou les mesures sociales et économiques, mais pas sur ce que doivent penser les citoyens (à moins de tendre vers ce que tout le monde prétend réprouver, le totalitarisme). À une époque où on multiplie les lois mémorielles, où des gens sont traînés devant les tribunaux pour insultes ou offenses envers un groupe donné, ou pour négation de certains faits historiques, et où chaque parole maladroite entraîne un déluge de protestations suivies le plus souvent d’excuses publiques (en d’autres temps et lieux, on disait « confession » ou «autocritique »), le moins que l’on puisse dire, c’est que la modeste proposition ci-dessus risque de passer pour aussi révolutionnaire qu’utopique.
Mais si chacun devrait pouvoir se réclamer de son identité préférée, il devrait également être permis à des personnes ayant grandi dans une certaine identité ou religion de rompre avec elle, de se révolter contre elle, et d’en faire la critique d’une certaine façon «de l’intérieur». Il ne manque pas de gens d’origine catholique, musulmane, française, allemande, etc. qui deviennent hypercritiques à l’égard de leur culture d’origine ; en général, on les considère comme des libres-penseurs. Mais pas quand ils sont juifs comme Atzmon. Celui-ci est certes obsédé par l’identité juive et par la critique de celle-ci; il est souvent excessif, provocateur, irritant même. Mais au nom de quoi un juif ne pourrait-il pas être hypercritique de sa culture d’origine, et ne pourrait-il pas être excessif, provocateur, irritant ? Je sais, par expérience personnelle, qu’Atzmon est loin d’être le seul dans son genre, même s’il est un des rares à l’être publiquement. N’est-ce pas une forme subtile d’antisémitisme que de refuser à. un juif le droit d’être un révolté par rapport à ses origines, alors que ce type de révolte est admis et même respecté lorsqu’il s’agit d’autres racines ? Un juif n’a-t-il pas droit aux excès de langage que l’on admire chez Sade ou Nietzsche ?
Une des questions les plus importantes soulevée par les écrits d’Atzmon est de savoir si ce qu’il dit est bon ou mauvais pour les Palestiniens (ce qui est indépendant de savoir si ce qu’il dit est vrai ou faux). La majeure partie du mouvement de solidarité avec les Palestiniens semble penser que c’est mauvais et cherche à se distancier autant que possible de ce «sulfureux personnage». C’est à mon avis, une gigantesque erreur, qui en reflète une autre plus fondamentale : ce mouvement donne souvent l’impression que la « solidarité » avec la Palestine se déroule avant tout là-bas et nécessite plus de missions, de voyages, de dialogues, d’information, et même parfois de «processus de paix ». Mais, la réalité est que les Israéliens ne veulent pas faire les concessions qui seraient nécessaires pour vivre en paix et qu’une des raisons de cette attitude est qu’ils croient pouvoir bénéficier ad vitam aeternam du soutien occidental.
C’est par conséquent ce soutien que le mouvement de solidarité devrait attaquer en priorité. Une autre erreur fréquente consiste à penser que ce soutien est dû à des considérations économiques ou stratégiques. Mais, aujourd’hui en tout cas, Israël ne sert en rien les intérêts occidentaux : il nous aliène le monde musulman, ne rapporte pas une goutte de pétrole, et pousse les États-Unis à déclencher une guerre avec l’Iran dont ceux-ci ne veulent manifestement pas (3). Les raisons du soutien sont en fait assez évidentes : les pressions constantes que les organisations sionistes font peser sur les intellectuels, les journalistes et les hommes politiques en manipulant sans arrêt l’accusation d’antisémitisme et le climat de culpabilité ou de repentance (par rapport à l’Holocauste) entretenu de façon artificielle, souvent par ces mêmes organisations. Par conséquent, la principale tâche du mouvement de solidarité avec la Palestine devrait être de permettre de parler librement de la Palestine, mais aussi de dénoncer les pressions et les manoeuvres d’intimidation des différents lobbies, ce à quoi se consacre justement Atzmon. Loin de le rejeter, le mouvement de solidarité devrait en priorité défendre la possibilité de le lire et de l’écouter, même si on n’est pas entièrement d’accord avec lui.
En fait, le rôle essentiel que joue Atzmon dans la solidarité avec la Palestine, en attaquant en force le «tribalisme» juif, est d’aider les non-juifs à se rendre compte que ce ne sont pas toujours eux qui sont coupables dans les conflits avec les organisations juives. Le jour où les non-juifs se libéreront du mélange de peur et d’intériorisation de la culpabilité qui les paralysent actuellement, le soutien à Israël s’effondrera.
Mon principal point de désaccord avec Atzmon concerne la religion; il exprime souvent une sympathie pour les religions et en particulier pour l’islam, sympathie que je ne partage pas, et qui va au-delà de la simple défense des droits démocratiques des musulmans ou des droits politiques des Palestiniens. Atzmon ne prétend être ni politiquement de gauche ni athée, ce qui est parfaitement son droit, mais étant les deux, je ne peux m’empêcher de considérer que la lutte pour maintenir la religion en dehors de la sphère publique est essentielle et n’est jamais vraiment terminée (aujourd’hui, elle devrait inclure la lutte contre la politique de l’identité). Atzmon ne semble même pas être particulièrement critique par rapport à la religion juive. Mais si, comme l’indiquent certains sondages, 70 % des Israéliens croient en un dieu qui a « élu » le peuple juif
(4) — croyance dont on ne sait pas s’il faut plus en dénoncer le racisme implicite ou la naïveté théologique comment considérer que cela n’a pas d’influence sur l’attitude israélienne face au reste du monde, et cette influence n’est-elle pas bien plus nocive que celle des juifs antisionistes auxquels Atzmon réserve ses flèches les plus acérées ?
Par ailleurs, s’il est normal et même noble, pour Atzmon, de s’attaquer en priorité à l’identité dont il est issu, il semble surestimer les particularités de celle-ci : des sentiments de suprématie et des volontés de domination existent dans tous les peuples, tous les groupes, et toutes les époques. Comme le faisait remarquer le pacifiste américain A.J. Muste, le problème dans toutes les guerres réside chez le vainqueur: la victoire lui a appris que la violence paie. On trouve en général plus d’humanité chez les vaincus, les Allemands et les Japonais après 1945, ou les Français après la fin de leur empire colonial. Mais la supériorité militaire d’Israël, ainsi que l’impunité
dont certains représentants de la communauté juive pensent pouvoir bénéficier lorsqu’ils diffament qui bon leur semble, ne font que renforcer les attitudes que dénonce Atzmon, mais qui n’ont rien de spécifiquement «juif»; ce sont malheureusement des propriétés humaines et universelles de gens qui se sentent en position de force. Le meilleur service que les non-juifs pourraient d’ailleurs rendre à la communauté juive serait en fait de résister aux pressions et à l’intimidation, au lieu d’y céder comme c’est le plus souvent le cas.
Finalement, quid du véritable antisémitisme ? Les propos d’Atzmon (ou les miens) ne l’encouragent-ils pas et n’est-il pas nécessaire de lutter contre ce fléau? Avant de répondre, voyons ce que cette « lutte » signifie en pratique. Il existe en France une loi interdisant de contester l’existence de faits liés aux persécutions contre les juifs pendant la seconde guerre mondiale.(5) Des gens sont poursuivis pour avoir prôné le boycott d’Israël (mais pas d’autres pays). Les spectacles ou les écrits qui heurtent la sensibilité des uns ou des autres sont multiples, et il est banal d’insulter ce qui est sacré aux yeux des musulmans ou des chrétiens, mais seuls les spectacles de Dieudonné sont régulièrement interdits. Il est risqué de discuter publiquement du lobby pro-israélien. Lors d’une émission de Daniel Mermet consacrée au lobby pro-israélien, John Mearsheimer a déclaré que Tony Judt (historien américain des idées, spécialiste de la France et cible lui-même du lobby pro-israélien aux États-Unis, bien que d’origine juive) lui avait dit que la France serait le pays où il lui serait le plus difficile de se faire entendre, ce qu’au départ Mearsheimer ne croyait pas, mais qu’il a pu vérifier par la suite.
11 me semble que si l’on est « démocrate», comme tout le monde prétend l’être, la première chose à faire est d’exiger l’égalité, au moins en principe, entre tous les êtres humains, en tout cas en ce qui concerne l’accès à la parole. Or, pour tout ce qui concerne Israël et les communautés juives organisées, ce n’est pas le cas. Il est par ailleurs impossible de combattre le communautarisme si on ne met pas d’abord tout le monde sur un pied d’égalité en ce qui concerne le droit à l’expression d’idées.
En particulier, en ce qui concerne l’accusation d’antisémitisme, une attitude démocratique devrait revendiquer le respect de trois principes :
– Que le terme antisémitisme soit bien défini et de façon telle qu’il soit critiquable : si, par exemple, on considère comme antisémite le fait de «défendre la liberté d’expression pour les négationnistes », ou de «contester la légitimité d’Israël», comme c’est souvent le cas, alors il faut simplement rejeter l’accusation et faire porter le débat sur la liberté d’expression ou sur le droit international.
– Que les accusations soient fondées sur des écrits et non sur des rumeurs ou des « interprétations ».
– Que les accusés puissent se défendre, ce qui est particulièrement difficile lorsqu’on fait face au tribunal de l’opinion publique, sauf si on arrive à entretenir dans cette opinion un sain scepticisme à l’égard de ce genre d’accusations, scepticisme que les écrits d’Atzmon encouragent.
Ceci dit, il est probable que le véritable antisémitisme (entendu comme hostilité généralisée à l’encontre des personnes d’origine juive) augmente, et cela de façon inquiétante. Mais cette montée est due avant tout à l’incroyable arrogance de la politique israélienne, à celle de ses soutiens en France, à leur volonté suicidaire d’imposer au peuple français à la fois une politique dont celui-ci ne veut pas et une censure de fait qui le musèle lorsqu’il cherche à protester. La «lutte contre l’antisémitisme» telle qu’elle est menée actuellement — peut-être avec les meilleures intentions du monde — ne fait que développer l’irritation que provoque toute censure et, dans ce cas d’espèce, ne fait que renforcer l’antisémitisme. Lutter réellement contre l’antisémitisme nécessite d’en finir avec la «lutte contre l’antisémitisme » fondée sur l’intimidation et la censure. Les gens qui ne comprennent pas cela devraient réfléchir un peu plus à l’histoire du socialisme réel ou du catholicisme à l’heure de sa gloire.
Jean Bricmont, février 2012.
…………………………………………
(1) Lire l’interview à cette adresse :www.silviacattori.net/artic1e2077.html
(2) Voir : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/20/97001-20111120FILWWW00182-libye-bhl-s-est-engage-en-tant-que-juif.php
(3)Pour une discussion plus approfondie, voir John Mearsheimer et Stephen Walt, Le Lobby Israélien, www.ism-france.org/analyses/Le-Lobby-Israelien-article-4470
ou Jean Bricmont, La désionisation de la mentalité américaine : www.ism-france.org/analyses/La-desionisation-de-la-mentaliteamericaine-article-6152
(4) Gideon Levy, «God Rules All in 2012 Israel, Even the State », Ha’aretz, 29 janvier 2012,www.haaretz.com/print-edition/opinion/god-rules-all-in-2012-israeleven-the-state-1.409739
(5) Il est vrai que l’on a ajouté à cette loi une nouvelle législation réprimant la négation du génocide arménien. On notera néanmoins que le chef de l’État s’est inquiété du fait que, si cette loi était jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, il n’y ait «ensuite un recours contre la pénalisation de la Shoah »,
www.lemonde.fr/politique/article/2012/01/31/genocide-armenien-des-senateurs-saisissent-le-conseil-constitutionnel-contre-le-texte_1636740_823448.html
Sur l’exploitation politique de la mémoire, voir le récent film de Béatrice Pignède, Main basse sur la mémoire. Les pièges de la loi Gayssot:
http://www.clap36.net/index.php?option —com_ content&view=article&id=89:main-basse-sur-la-memoire-les-pieges-de-laloi-gayssot&catid=12:projets&Itemid=34 |