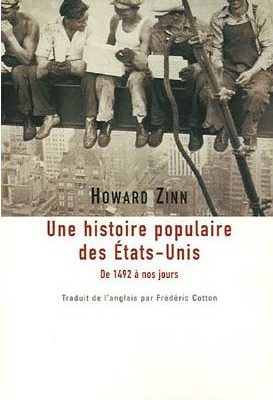![zin_hpeus[1]](http://www.comiteactionpalestine.org/word/wp-content/uploads/2014/04/zin_hpeus1.jpg) Fiche de lecture du livre d’Howard Zinn : « Une histoire populaire des Etats-Unis, de 1942 à nos jours » (éditions Agone, 2002).
Fiche de lecture du livre d’Howard Zinn : « Une histoire populaire des Etats-Unis, de 1942 à nos jours » (éditions Agone, 2002).
C’est le propre de la fiction de transfigurer la réalité. Lorsque cette fiction se met au service d’un État ou d’un système économique, elle se nomme propagande idéologique. On se souvient peut-être de 1492, le film commémorant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, tourné quelque cinq cents ans plus tard. On y voyait Gérard Depardieu, sur une plage de violons, baiser le sable de l’île d’Hispaniola, avant de se frotter à des indigènes menaçants… En réalité, les Arawaks au complet “abandonnèrent leurs villages pour se rendre sur le rivage, puis nagèrent jusqu’à cet étrange et imposant navire afin de mieux l’observer.” Christophe Colomb tenait un journal de bord et il note lui-même que les Arawaks “ont apporté des perroquets, des pelotes de coton, des lances et bien d’autres choses qu’ils échangeaient contre des perles de verre et des grelots. Ils échangeaient volontiers tout ce qu’ils possédaient […] Ils ne portent pas d’armes.” Passée la surprise des premiers instants, le caractère propre à la civilisation occidentale reprend le dessus, et Colomb écrit ce commentaire prophétique : “Ils feraient d’excellents domestiques […] Avec seulement cinquante hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons.” Les choses étaient dès le départ mal engagées. On sait ce qu’il advint par la suite des Indiens de tout ce continent nouvellement découvert. Et les cinq siècles qui suivirent ne furent guère plus réjouissants.
Une entreprise de démythification
Toute l’entreprise de Howard Zinn est, dans un premier temps, de détruire les mythes américains. Cette épopée du Nouveau Monde et de ses illustres figures -ses “sauveurs”, comme ils sont considérés dans les livres d’histoire outre-Atlantique-, Colomb et les pionniers, les Pères Fondateurs pour la Révolution , Lincoln pour la sortie de l’esclavage, Roosevelt pour la Grande Dépression, Carter pour la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate…, Zinn s’attache à la désacraliser, et à l’inscrire dans un contexte matérialiste qui fait la part belle aux obscurs, aux sans-grade, à ceux dont on ne parle jamais mais qui n’en sont pas moins les véritables acteurs de l’histoire. Partant, il rend ainsi hommage à d’innombrables figures oubliées. Le parti pris est évident et totalement revendiqué. Selon l’auteur lui-même, il s’agit d’une “histoire irrespectueuse à l’égard des gouvernements et attentive aux mouvements de résistance populaire. Une histoire qui penche clairement dans une certaine direction, ce qui ne me dérange guère tant les montagnes de livres d’histoire sous lesquelles nous croulons penchent clairement dans l’autre sens.”
Un pays fondamentalement raciste
Même si l’on en parle peu, on connaît assez bien la douloureuse tragédie des Indiens. Véritable génocide, leur massacre organisé s’est déroulé sur près de quatre cents ans, en fonction des velléités expansionnistes du nouvel empire qui se constituait. La technique est toujours la même : profiter de la supériorité militaire pour accaparer de nouvelles terres, refouler les Indiens, leur promettre la tranquillité sur leurs nouveaux lieux de vie, trahir la parole donnée et pousser toujours plus loin la conquête. Les colons ont toujours utilisé la politique du fait accompli pour refuser de rendre les terres volées ; une fois qu’ils étaient installés quelque part, ils ne pouvaient plus se retirer. Le tout s’accompagnant bien sûr de déportations, de massacres, de mensonges et d’hypocrisie humaniste ou sécuritaire. Troublant parallèle avec ce qui se fait actuellement en Palestine occupée… Durant cette cohabitation sanguinaire, près de quatre cents traités ont été signés entre les Indiens et les différents gouvernements ; aucun n’a été respecté.
On sait bien sûr que la richesse des premiers propriétaires terriens de l’Est et du Sud s’est constituée grâce à l’esclavage. Zinn estime à cinquante millions le nombre de Noirs qui ont eu à en souffrir. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que l’histoire de ces Noirs n’est qu’une longue série de révoltes, d’insoumissions, et de massacres qui n’ont rien à envier à ceux perpétrés contre les Indiens. Nous sommes loin de l’image du bon nègre soumis à l’autorité du maître paternaliste, comme Autant en emporte le vent le laisse suggérer. Ce que l’on tait également, c’est que beaucoup de Blancs -appelés serviteurs sous contrat- étaient aux ordres de ces grands propriétaires, et que bien vite, unis dans une même servitude, exploités blancs et noirs ont donné des signes d’alliance possible. Zinn montre très bien que, face à cette montée en puissance de conflits de classe, le racisme s’est érigé en instrument de contrôle social. “Si des hommes libres, au désespoir, avaient dû faire cause commune avec des esclaves désespérés eux aussi, les conséquences auraient pu dépasser en violence tout [ce qui se faisait alors]. La solution à ce problème, évidente mais jamais formulée -simplement progressivement assumée-, était le racisme, seul outil susceptible de ségréguer les Blancs dangereux des esclaves dangereux en élevant entre eux le mur du mépris social.”
Le racisme est donc un élément fondamental de la politique des États-Unis, et ce, dès l’époque des premiers colons. Pendant les siècles qui suivirent, il fut un des instruments de la domination des capitalistes sur les travailleurs, les syndicats eux-mêmes ayant beaucoup de mal à intégrer des Noirs dans leurs rangs. Zinn rappelle ironiquement que l’intervention américaine pendant la seconde guerre mondiale n’obéissait pas encore vraiment à des motivations humanistes : “Faisait-on réellement la guerre pour démontrer que Hitler se trompait quant à la supériorité de la “race” aryenne sur les races inférieures ? Dans les forces armées américaines, les Blancs et les Noirs restaient séparés. Lorsque, au début de 1945, les troupes furent embarquées sur le Queen Mary pour aller combattre sur le sol européen, les soldats noirs prirent place dans les profondeurs du navire à côté de la salle des machines, aussi loin que possible de l’air frais du pont, dans une sorte d’étrange remake des transports d’esclaves d’autrefois. La Croix-Rouge, avec l’accord du gouvernement, ne mélangeait pas le sang des Noirs avec le sang des Blancs.”
L’intervention américaine obéissait donc à d’autres impératifs. Lesquels ? Toujours les mêmes : satisfaire les besoins expansionnistes du capitalisme dominant. La guerre de Sécession (1861-1865) en fut un exemple significatif. Traditionnellement, on oppose les bons Nordistes et Lincoln aux méchants Sudistes esclavagistes. En réalité, les faits furent un peu plus complexes et les résultats moins glorieux qu’on veut bien le prétendre. Les incessantes révoltes des Noirs, appuyées par quelques Blancs abolitionnistes, mettaient en péril un système parfaitement rodé. De nombreux documents témoignent du fait que les propriétaires esclavagistes vivaient dans la peur. Ils étaient obligés d’utiliser les pires méthodes pour mater les Noirs, ce qui ne fonctionnait que très épisodiquement. Il faut rappeler également que, du fait de l’arrivée incessante et massive d’esclaves, les Noirs étaient devenus largement majoritaires dans les États du Sud, et les propriétaires se sentaient quelque peu envahis par cette horde de sauvages assoiffés de sang. Il fallait réagir : “Un soulèvement général risquait de se révéler incontrôlable et de libérer des forces qui pourraient s’en prendre, au-delà de l’esclavage, au système d’enrichissement capitaliste le plus efficace du monde. En cas de guerre généralisée, en revanche, ceux qui la conduiraient pourraient en maîtriser les conséquences.”
L’abolition ne fut donc pas le fait d’une prise de conscience humaniste, mais obéit à des impératifs purement économiques. Lincoln lui-même, considéré aux États-Unis comme un héros, est présenté comme un personnage fort ambigu. Ses discours semblaient motivés par l’opportunisme le plus évident. Selon le public auquel il s’adressait, il était capable de tenir des propos soit racistes soit abolitionnistes. Toujours est-il que les esclaves furent affranchis et que tout le monde y trouva son compte -les dirigeants, s’entend. Le capitalisme moderne s’étendit ainsi dans tous les États, du Nord au Sud, les affaires furent plus florissantes que jamais, et des millions de travailleurs, Noirs et Blancs, se retrouvèrent dominés par un nouveau système d’exploitation, beaucoup plus performant et beaucoup plus rentable. Un analyste de la situation de l’époque, W.E.B. Du Bois, affirma que pendant cette croissance du capitalisme américain avant et après le guerre de Sécession, Blancs et Noirs vivaient tous en esclavage.
Le racisme ne disparut évidemment pas pour autant : “Lorsque la guerre de Sécession prit fin, dix-neuf des vingt-quatre États du Nord n’accordaient toujours pas le droit de vote aux Noirs. En 1900, tous les États du Sud, par de nouvelles constitutions et de nouveaux statuts, avaient inscrit dans la loi la suppression du droit de vote et la ségrégation pour les Noirs. Un éditorial du New York Times affirmait que “les hommes du Nord […] ne dénoncent plus la suppression du droit de vote pour les Noirs. […] La nécessité de cette suppression, au motif suprême de l’autopréservation, semble désormais candidement reconnue.” Il faudra attendre les années 1960, et les révoltes en faveur des droits civiques -autre période particulièrement trouble et sanguinaire-, pour que les Noirs aient accès aux même titre que les autres à un minimum de représentation. Et le problème est loin d’être résolu. Aux États-Unis, et encore de nos jours même si c’est plus diffus, le racisme se présente comme un formidable outil de maintien de l’ordre capitaliste.
Une fausse Révolution
La Révolution de 1776 apparaît également dans cet ouvrage comme une vaste fumisterie. Le terme n’est pas trop fort tant le “peuple” de l’époque manifesta peu d’intérêt pour aller se battre contre les Anglais. Les pauvres, Blancs et Noirs, les plus nombreux, ne voyaient pas bien ce que pourrait leur procurer le fait de changer de maîtres, ou plutôt le fait que leurs maîtres s’émancipassent de la tutelle anglaise pour mieux asseoir leur puissance économique. Ils furent pour la plupart enrôlés de force dans l’armée de libération et ne manifestèrent guère l’enthousiasme patriotique dont fait preuve Hollywood lorsque l’industrie du cinéma se penche sur cette période.
De fait, la Déclaration d’indépendance obéit à des objectifs moins avouables que ce que l’on croit d’ordinaire : “Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d’Amérique [Les Pères Fondateurs] firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des deux siècles suivants. Ils imaginèrent qu’en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée “États-Unis”, ils seraient en mesure de s’emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs détenus jusque-là par les protégés de l’Empire britannique. Du même coup, ils pourraient contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée.”
Cette idée de génie connut le succès que l’on sait, et c’est ainsi qu’une nouvelle classe dominante fit son apparition, s’appuyant sur une Constitution profondément et fondamentalement libérale, dans le sens où elle donnait tous les pouvoirs aux riches et laissait l’immense masse des pauvres patauger dans le mythe toujours actuel d’une éventuelle ascension sociale.
La lutte des classes
Dès le début, les États-Unis furent la patrie du capitalisme triomphant, sûr de son bon droit et de sa force. Ce qui ne signifie pas que l’histoire se déroula sans heurts. Au contraire, le livre de Zinn fourmille d’exemples montrant que la lutte de classes a toujours été d’actualité dans cet empire qui se constituait peu à peu. Et l’on est étonné face au nombre impressionnant de conflits qui émaillent l’histoire du pays. Que ce soit contre les travailleurs noirs, les ouvriers blancs, parfois -plus rarement- contre les deux unis, les capitalistes ont toujours eu d’énormes problèmes pour assurer la main-mise sur la classe populaire. Mais ils ont toujours utilisé la même méthode pour en venir à bout, et que l’on cache prudemment dans les manuels d’histoire : la plus extrême violence.
Témoin ce qui se passa en 1914 dans une mine du Colorado : “Dès que la grève éclata, les mineurs furent expulsés des logements qu’ils occupaient dans les villes possédées par la compagnie minière.[…] Ils établirent des campements de tentes dans les collines voisines et poursuivirent la grève en maintenant les piquets de grève. Le service d’ordre engagé par les représentants des Rockefeller utilisait des fusils-mitrailleurs et des carabines et effectuait des raids sur les campements de grévistes. […] En avril 1914, deux compagnies de la garde nationale se tenaient dans les collines surplombant le plus important campement de mineurs. […] Les femmes et les enfants creusèrent des fosses sous les tentes pour échapper aux tirs des mitrailleuses. Au crépuscule, les gardes nationaux descendirent des collines pour mettre le feu au campement. […] Le lendemain, un employé du téléphone passant à travers les ruines du campement souleva une plaque d’acier qui recouvrait une fosse creusée dans l’une des tentes et découvrit les corps carbonisés, recroquevillés.” Cet événement est aujourd’hui connu sous le nom de massacre de Ludlow. Il n’est qu’un exemple parmi la longue liste d’abominations commises par les richissimes patrons pour contraindre la classe ouvrière à se soumettre.
Il faut dire que celle-ci, malgré la répression permanente, lutta sans interruption, parfois les armes à la main, pour tenter d’obtenir son émancipation. Juste après la première guerre mondiale, de nombreuses constitutions de ce que l’on est tenté d’appeler des Soviets firent leur apparition. En 1919, à Seattle, la ville fut gérée par les grévistes. “Pendant la grève, la criminalité diminua. Le commandant du détachement militaire envoyé dans la région confia aux grévistes qu’il n’avait jamais vu une ville aussi calme et aussi bien gérée.” Mais ces expériences firent toutes long feu, si l’on peut dire, et, peu à peu, la classe ouvrière fut matée. Les rebelles furent exécutés, ou longuement emprisonnés, ou disparurent sans laisser de traces. Ce n’est pas le moindre des mérites de l’ouvrage de Zinn que de leur rendre là un dernier hommage. La législation fut savamment adaptée pour qu’elle accable toujours les plus faibles.
Incidemment, l’auteur règle son compte à une procédure juridique qui tente de faire son apparition en France ces derniers temps, celle dite de la “peine négociée” : “L’acte final de la procédure de peine négociée est une vaste supercherie qui rivalise elle-même de malhonnêteté avec le crime dont il est question dans bien des cas. L’accusé est contraint de reconnaître publiquement sa culpabilité pour un crime que, bien souvent, il n’a pas commis. Il doit ensuite préciser qu’il a avoué sans y être contraint […] et sans qu’on lui ait fait aucune promesse en retour. Dans la peine négociée, l’accusé plaide coupable, qu’il le soit ou non, épargnant ainsi à l’État, contre la promesse d’une réduction de sa condamnation, la peine d’avoir à le juger.” Les Français sont avertis de ce qui les attend si une telle loi apparaît dans leur pays.
Le consensus bipartisan
Le peuple américain, vivant dans ce que l’on considère comme la plus grande démocratie du monde, pourrait espérer compter sur ce que l’on appelle l’alternance politique, pour voir ses intérêts défendus de temps à autre. Hélas, en fonction de ce que Zinn nomme le “consensus bipartisan”, républicains et démocrates, au cours de leur longue histoire, ont toujours soutenu de façon indéfectible les intérêts des possédants : “La position politique adoptée par les différents candidats ayant participé aux primaires des principaux partis s’est toujours limitée à l’horizon défini par les notions de propriété et d’entreprise. […] Ils acceptaient l’idée que les vertus économiques de la culture capitaliste étaient inhérentes à la nature humaine. […] Et cette culture a toujours été fondamentalement nationaliste.”
Les deux grands partis ont ainsi pour tradition bien établie d’abandonner la population à la loi du “libre marché”. Un exemple ? “Sous Reagan, le gouvernement avait réduit le nombre de logements sociaux de quatre cent mille à quarante mille ; sous Clinton, on les supprima totalement.” Pas étonnant donc que les différentes campagnes électorales se concentrent davantage sur le fait de savoir si tel ou tel candidat a été un bon patriote, s’il est un bon mari ou si sa femme fait bien la cuisine, se transformant alors en un immense show médiatique et démagogique. Bien évidemment, tout rapprochement effectué avec notre propre alternance française serait purement fortuit…
Nationalisme, colonialisme et mensonges
“Entre nous, […] j’accueillerais avec plaisir n’importe quelle guerre tant il me semble que ce pays en a besoin.” Voilà ce que Théodore Roosevelt écrivait à un ami en 1897. Zinn rappelle que la culture capitaliste américaine est, comme nous l’avons vu plus haut, “fondamentalement nationaliste.” En effet, la guerre présente le triple avantage de souder une conscience nationale et de développer les sentiments patriotiques, de faire ainsi oublier les problèmes internes et les conflits de classe, et de permettre au marché de trouver de nouveaux territoires pour écouler les produits. Ce fait n’est pas nouveau et l’actualité récente en offre bien des exemples. Il est d’ailleurs un des fondements du capitalisme, comme Lénine l’avait déjà remarqué à son époque. Or, l’histoire des États-Unis n’est qu’une longue série de conflits et de guerres extérieures. Les dirigeants américains ont toujours pris soin de présenter à leurs administrés des ennemis bien définis et bien diaboliques.
Tout le monde a en mémoire Saddam Hussein, l’Islam, et auparavant le communisme. Mais cette fabrication d’un ennemi, devant satisfaire le triple objectif précédemment cité, est une vieille histoire. Entre 1798 et 1895, par exemple, cent trois opérations extérieures eurent lieu, particulièrement centrées vers Hawaii, le Japon, la Chine, et surtout l’Amérique latine. Définie en 1823, la “doctrine Monroe” entendait faire clairement comprendre aux Européens, alors que les pays d’Amérique latine prenaient leur indépendance vis-à-vis de l’Espagne, que les États-unis considéraient désormais ces pays comme relevant de leur zone d’influence. On sait par quoi cela se traduisit dans les siècles suivants, Zinn en développe les détails les plus significatifs.
Concernant d’ailleurs les relations entretenues avec l’Amérique latine, John O’Sullivan, rédacteur en chef de la Democratic Review, devait utiliser en 1845 cette formule devenue fameuse : c’est la “destinée manifeste du peuple américain que de se répandre sur le continent que la Providence lui a assigné afin de permettre le libre développement de notre population qui croît annuellement de plusieurs millions d’individus.” Destinée manifeste, en effet. De tels propos permettent un peu de comprendre pourquoi, toutes proportions gardées quant aux chiffres, les États-Unis et Israël se sentent si proches aujourd’hui dans leurs justifications idéologiques.
Un fait est frappant lorsqu’on observe les raisons invoquées pour entrer en guerre. Il s’agit bien évidemment de prétextes, d’agressions supposées et d’appels à la légitime défense. Ce fut le cas pour l’invasion du Mexique en 1846. Un certain colonel Cross, “disparut au cours d’une expédition le long du Rio Grande. Son corps fut retrouvé onze jours plus tard, le crâne défoncé. On prétendit qu’il avait été assassiné par un groupe de guérilleros mexicains ayant osé traverser la rivière.” La guerre était lancée, faisant quelques milliers de morts de part et d’autre.
En février 1898, un navire de guerre américain, le Maine, qui se trouvait dans le port de La Havane fut détruit par une mystérieuse explosion et sombra avec deux cent soixante-huit hommes d’équipage. “Sans preuves, le rapport officiel américain accusa immédiatement l’Espagne, laquelle proposa aussitôt de confier l’enquête à une commission mixte. Les États-Unis refusèrent. Il est intéressant de noter qu’il n’y eut aucun gradé parmi les victimes. Tous les officiers du Maine, ce soir-là, étaient à une réception en ville.” Toujours est-il que les États-Unis entrèrent en guerre avec l’Espagne, chassèrent les Espagnols de Cuba et occupèrent l’île sans se préoccuper davantage des légitimes revendications d’indépendance des Cubains.
En 1914, une grave récession avait frappé les États-Unis. Malgré les déclarations de Woodrow Wilson qui avait promis que son pays resterait neutre (“Il est des nations trop fières pour se battre” ), les États-Unis avaient besoin de stimuler leur économie grâce au marché des armes. Lorsque, au début de 1915, le paquebot anglais Lusitania fut coulé par un sous-marin allemand, cent vingt-quatre Américains sombrèrent avec lui. Les États-Unis prétendirent que ce paquebot ne transportait qu’un chargement inoffensif et que les Allemands avaient commis un crime épouvantable qui obligeait l’Amérique à entrer en guerre. “En fait, le Lusitania transportait bel et bien mille deux cent quarant-huit caisses d’obus et quatre mille neuf cent vingt-sept boîtes de mille cartouches chacune ainsi que deux mille caisses de munitions pour des armes de poing. Son manifeste fut falsifié ultérieurement pour dissimuler cette réalité, et les gouvernements anglais et américain mentirent à propos de sa cargaison.”
Concernant l’entrée en guerre des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, s’il est évident qu’ils n’ont pas bombardé eux-mêmes Pearl Harbor, il n’en reste pas moins vrai qu’ils ont tout fait pour que le Japon le fasse. Il est désormais certain que Franklin Roosevelt mentit à propos de deux événements impliquant des sous-marins allemands et un destroyer américain. L’un des juges du procès pour crimes de guerre qui se tint à Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, affirma que les États-Unis, en décrétant l’embargo sur le fer et le pétrole qui menaçait l’existence même du Japon, avaient à l’évidence provoqué la guerre avec le Japon et qu’ils avaient espéré que le Japon réagirait. “Les archives montrent qu’une réunion à la Maison-Blanche, deux semaines avant Pearl Harbor, anticipait une guerre et s’interrogeait sur les moyens de la justifier.” Les Japonais ayant attaqué, les Américains leur déclarèrent la guerre ; les Allemands déclarèrent à leur tour la guerre aux États-Unis, qui finirent par débarquer en Europe, et l’on connaît la suite…
Au mois d’août 1964, Lyndon Johnson et son secrétaire d’État à la Défense, Robert MacNamara, informèrent la population américaine que des événements tragiques avaient eu lieu dans le golfe du Tonkin, pour démarrer une guerre de grande ampleur au Vietnam. MacNamara affirma que, “au cours d’une patrouille de routine dans les eaux internationales, le destroyer américain Maddox avait été l’objet d’une agression injustifiable” de la part des torpilleurs nord-vietnamiens. “En réalité, la CIA était bel et bien engagée dans une opération secrète dont la cible était les installations côtières nord-vietnamiennes. Ainsi, s’il y avait bien eu attaque, elle n’était pas “injustifiable”. En outre, le Maddox était en mission d’espionnage. De même, il ne naviguait pas dans les eaux internationales, mais en zone vietnamienne. […] Une autre “attaque” contre un autre destroyer américain, deux nuits plus tard -agression que Johnson qualifia d’”agression délibérée”- semble également avoir été inventée de toutes pièces.”
Cette longue série de prétextes et de mensonges -non exhaustive ici- pour satisfaire des intérêts peu avouables, ne manque pas d’interroger. Howard Zinn livre peu d’informations concernant les attentats du 11 septembre 2001. L’actualité est encore trop chaude et nous ne disposons pas encore de suffisamment d’éléments pour analyser cet événement de façon à en comprendre clairement les tenants et aboutissants. Toutefois, à la lumière de ce que fut l’histoire des États-Unis par le passé, il n’est pas interdit de penser que les faits ne se déroulèrent peut-être pas de la façon dont les médias, bien aidés en cela par l’Administration américaine, en rendirent compte. Toujours est-il que désormais, nous savons que les États-Unis sont capables de mentir officiellement, et de sacrifier un certain nombre de leurs compatriotes pour satisfaire des intérêts économiques. Si certains en doutaient encore, l’ouvrage de Zinn leur sera d’une lecture édifiante.
Un ouvrage salutaire
On reste quelque peu assommé après avoir terminé ce livre monumental, impossible à résumer et dont on ne peut évidemment rendre compte dans sa totalité. Face à tant de bassesses, de turpitudes, d’hypocrisie, de soutiens inconditionnels aux régimes les plus malodorants -il y aurait beaucoup à dire sur l’histoire de la CIA-, on est tenté de croire que les États-Unis figurent parmi les États les moins fréquentables au monde. Et qu’ils sont même l’État le moins fréquentable, compte tenu du rôle de superpuissance mondiale qu’il possède désormais, et de l’influence qu’il exerce sur la totalité du globe.
Toutefois, le but poursuivi par Howard Zinn n’est pas de détruire son pays. Mais il tient manifestement à ce que tous ouvrent les yeux sur la réalité de ce que l’on cite toujours comme un modèle de démocratie, d’intégration et de liberté.
On ne résiste pas ici à l’envie de reproduire dans son intégralité un passage dans lequel l’auteur décrit ironiquement ce que l’on considère souvent comme des avancées sociales :
“N’est-ce pas une formidable idée que de faire payer par la classe moyenne les impôts qui garantiront l’aide sociale apportée aux pauvres ? -ajoutant ainsi la rancœur des premiers à l’humiliation des seconds. Et que dire de la politique qui consiste à déplacer, par l’intermédiaire du ramassage scolaire, les écoliers noirs des milieux défavorisés vers les écoles des quartiers blancs défavorisés en une sorte d’échange cynique entre écoles de pauvres ? Pendant ce temps-là, les écoles réservées aux riches étaient protégées, et les fonds publics distribués avec tant de parcimonie aux enfants nécessiteux étaient engloutis dans la construction d’avions de combat coûtant des milliards de dollars. Ingénieux, également, de répondre aux revendications d’égalité des femmes et des Noirs en leur accordant de maigres privilèges spécifiques et en les mettant en compétition avec tous les autres pour la recherche de ces emplois qu’un système irrationnel et incohérent rendait extrêmement rares. Pas mal non plus, cette idée de focaliser les craintes et la colère de la majorité silencieuse sur une classe de criminels, fruits de l’injustice économique toujours produits en plus grand nombre qu’il n’est possible d’en emprisonner, permettant ainsi de mieux dissimuler le gigantesque pillage des ressources nationales entrepris en toute légalité par de nombreux dirigeants.”
Dans un autre paragraphe, Howard Zinn offre un concentré de ce que semblent être les U.S.A : “Il n’existe pas d’autres systèmes de contrôle capables d’offrir autant d’opportunités, de possibilités, de latitude, de souplesse et de récompenses aux heureux gagnants de la loterie sociale. Il n’en est pas non plus qui répartisse ses outils de contrôle de manière aussi sophistiquée -par le vote, la hiérarchie du travail, l’Église, la famille, l’enseignement, les mass-médias-, ni aucun qui ne sache aussi bien endormir son opposition en faisant quelques réformes, en isolant les individus, en mettant l’accent sur la loyauté patriotique.”
Pour autant, si Zinn dénonce les agissements et les structures politiques et économiques de son pays, il n’en reste pas moins vrai qu’il éprouve un profond respect pour son peuple -ou devrait-on dire ses peuples ? Tout l’ouvrage en témoigne, en lui donnant la parole, en mettant l’accent sur ses réactions et ses révoltes, bien plus nombreuses et farouches qu’on ne le croit. Car, aussi sophistiqué soit-il, aucun système n’a jamais réussi à se garantir des révoltes populaires. Et aucune élite au pouvoir n’a pu définitivement se prémunir contre cette capacité des gens apparemment désarmés à résister, des gens apparemment satisfaits à envisager des changements. Pour tous ces gens-là, pour ces oubliés de l’histoire, il fallait faire un livre. Il fallait écrire une histoire. “Faire cette histoire, c’est retrouver chez l’homme ce formidable besoin d’affirmer sa propre humanité. C’est également affirmer, même dans les périodes les plus pessimistes, la possibilité de changements surprenants.”
On l’aura certainement compris, cette Histoire populaire des États-Unis n’est nullement un brûlot anti-américain, encore moins un manifeste anti-américains. Il est juste un formidable ouvrage qui met en lumière les iniquités d’un système économique aberrant, fondamentalement injuste, raciste et colonialiste : le capitalisme.
Autant dire que l’on ferait œuvre de salubrité publique si l’on imposait sa lecture dans toutes les écoles de ce monde en proie aux manipulations de toutes sortes. Il n’est pas interdit de rêver…
Serge L.